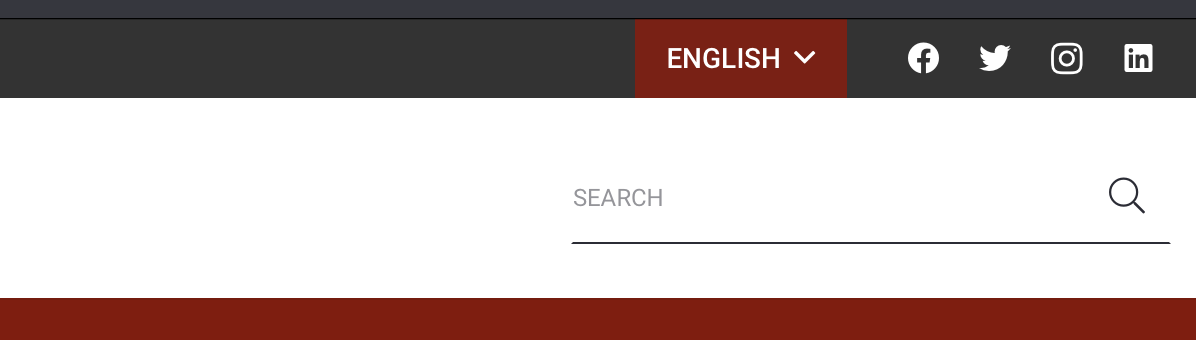Aperçu de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC
L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce est une pierre angulaire du régime mondial de la propriété intellectuelle (PI). Signé en 1994 et entré en vigueur en 1995, l’Accord sur les ADPIC établit des normes minimales pour la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle (DPI) entre tous les membres de l’OMC. L’accord couvre un large éventail de domaines de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur, les marques, les indications géographiques et les brevets, avec des implications importantes pour le secteur pharmaceutique.
Dans le contexte des brevets pharmaceutiques, l’Accord sur les ADPIC impose aux États membres de fournir une protection par brevet pour les inventions, y compris les médicaments, pendant au moins 20 ans à compter de la date de dépôt. Cette protection confère au titulaire du brevet les droits exclusifs de fabrication, d’utilisation, de vente et d’importation du médicament breveté, créant ainsi un monopole temporaire. L’objectif est d’encourager l’innovation en permettant aux entreprises de récupérer les coûts substantiels associés à la recherche et au développement (R&D) et à l’approbation réglementaire des nouveaux médicaments. Sans une telle protection, les sociétés pharmaceutiques seraient confrontées au risque que leurs concurrents reproduisent rapidement leurs innovations et érodent leurs bénéfices potentiels.
Cependant, l’Accord sur les ADPIC reconnaît également que ce système peut créer des obstacles à l’accès aux médicaments essentiels, en particulier dans les PFR-PRI. En reconnaissance de cela, l’accord comprend plusieurs flexibilités conçues pour permettre aux pays de donner la priorité à la santé publique sur les droits de brevet dans certaines circonstances. Ces flexibilités ont été formalisées dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (2001), qui affirme que les ADPIC ne devraient pas empêcher les États membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique, en particulier dans le contexte de l’accès aux médicaments.
La proposition de dérogation de l’OMC pour les vaccins et les traitements contre la Covid-19
La pandémie de Covid-19 a exposé des inégalités significatives dans le système de santé mondial, en particulier dans la distribution et la disponibilité des vaccins et des traitements. Alors que les sociétés pharmaceutiques ont pu développer des vaccins en un temps record, en grande partie grâce à la recherche préexistante sur les coronavirus et à un financement public sans précédent, la distribution initiale de ces vaccins était très inégale. Les pays à revenu élevé ont obtenu d’importantes parts de l’approvisionnement en vaccins grâce à des accords d’achat anticipé, tandis que les PFR-PRI ont eu du mal à accéder aux doses nécessaires.
En réponse à cette inégalité, plusieurs pays en développement, dirigés par l’Inde et l’Afrique du Sud, ont proposé une dérogation temporaire à certaines dispositions de l’Accord sur les ADPIC en octobre 2020. Cette proposition, communément appelée la dérogation aux ADPIC, visait à permettre aux membres de l’OMC de renoncer à la protection des brevets et autres DPI pour les vaccins, les traitements et les diagnostics contre la Covid-19 pendant la durée de la pandémie. L’objectif était d’éliminer les obstacles juridiques et économiques à la fabrication locale de vaccins et de traitements, augmentant ainsi l’offre et l’accès mondiaux, en particulier dans les PRFI.
Les principales dispositions de la dérogation proposée comprenaient :
- Renonciation aux brevets pour les produits médicaux liés au Covid-19, y compris les vaccins, les traitements et les diagnostics.
- Permettre temporairement aux pays de produire ces produits sans faire face à la menace d’une action en justice de la part des titulaires de brevets.
- Faciliter le transfert de technologie et le partage de savoir-faire pour permettre la production locale dans les PRFI.
La dérogation a été envisagée comme une mesure d’urgence temporaire, destinée à ne durer que pendant la durée de la pandémie ou jusqu’à ce que l’immunité collective soit atteinte à l’échelle mondiale.
Arguments pour et contre la renonciation à l’OMC
La proposition de dérogation aux ADPIC a suscité un débat intense parmi les membres de l’OMC, les sociétés pharmaceutiques, les experts de la santé publique et les organisations de la société civile. Les arguments pour et contre la dérogation reflètent la tension plus large entre la protection de la propriété intellectuelle pour encourager l’innovation et assurer un accès mondial aux médicaments vitaux.
Arguments en faveur de la renonciation
- Aborder les inégalités mondiales dans la distribution des vaccins : les partisans de la dérogation soutiennent que le système de propriété intellectuelle existant n’a pas réussi à assurer un accès équitable aux vaccins et aux traitements contre la Covid-19, en particulier pour les PRFI. En renonçant à la protection des brevets, affirment-ils, les PRFI seraient en mesure de produire leurs propres vaccins, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des approvisionnements des pays à revenu élevé et des sociétés pharmaceutiques. Cela, à son tour, aiderait à remédier aux disparités criantes dans l’accès aux vaccins qui ont caractérisé la réponse à la pandémie.
- Extension de la capacité de fabrication mondiale : la dérogation permettrait aux fabricants de pays ayant une capacité de production suffisante, tels que l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil, de produire des vaccins et des traitements contre la Covid-19 sans risque de poursuites en contrefaçon de brevet. Cela augmenterait l’offre mondiale et réduirait la dépendance à l’égard d’un petit nombre d’entreprises et de pays pour la production de vaccins, ce qui pourrait accélérer la fin de la pandémie.
- Considérations humanitaires : les défenseurs de la dérogation soutiennent que la pandémie de Covid-19 représente une crise humanitaire mondiale et que la santé publique devrait primer sur les bénéfices des entreprises. Ils soulignent que la nature extraordinaire de la pandémie nécessite des mesures extraordinaires, et la renonciation aux droits de brevet est une étape nécessaire pour sauver des vies. En outre, ils font valoir que de nombreux vaccins ont été développés avec un financement public important, ce qui signifie que le public devrait avoir davantage son mot à dire dans la façon dont ils sont distribués.
Arguments contre la renonciation
- Saper les incitations à l’innovation : les opposants, en particulier de l’industrie pharmaceutique, soutiennent que la dérogation aux ADPIC saperait les incitations qui stimulent l’innovation pharmaceutique. Les brevets, affirment-ils, sont essentiels pour s’assurer que les entreprises peuvent récupérer leurs investissements en R&D. Sans la promesse d’une protection par brevet, les entreprises pourraient être moins disposées à investir dans le développement de nouveaux traitements ou vaccins à l’avenir. Cela pourrait avoir des effets négatifs à long terme sur l’innovation, en particulier pour les maladies qui affectent principalement les PRFI.
- Des mécanismes alternatifs existent déjà : les critiques de la dérogation soulignent que l’Accord sur les ADPIC comprend déjà des flexibilités, telles que l’octroi de licences obligatoires, qui permettent aux pays de contourner les protections par brevet en cas d’urgence de santé publique. Selon eux, ces mécanismes devraient être utilisés plus efficacement plutôt que de renoncer entièrement à la protection de la propriété intellectuelle. En outre, les opposants soulignent que les problèmes liés à la pandémie, tels que la distribution de vaccins et les goulots d’étranglement de la fabrication, sont souvent dus à des problèmes logistiques plutôt qu’à des obstacles à la propriété intellectuelle.
- Préoccupations concernant la sécurité et la qualité : certains critiques expriment également des préoccupations concernant la sécurité et la qualité des vaccins et des traitements produits sans la participation des détenteurs de brevets d’origine. Ils soutiennent que la simple renonciation aux brevets ne garantit pas le transfert de la technologie complexe et du savoir-faire nécessaires à la fabrication de vaccins comme les vaccins Covid-19 à base d’ARNm. Sans une surveillance appropriée, il pourrait y avoir des problèmes liés au contrôle de la qualité, à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins produits dans le cadre de la dérogation.
Précédents et mise en œuvre actuelle des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC
La proposition de dérogation aux ADPIC n’est pas sans précédent. Au cours des deux dernières décennies, plusieurs crises sanitaires mondiales ont incité les pays à utiliser les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, en particulier les licences obligatoires, pour faire face aux urgences de santé publique.
La crise du VIH/sida et la Déclaration de Doha
La pandémie de VIH/sida à la fin des années 1990 et au début des années 2000 a marqué un tournant dans le débat mondial sur l’accès aux médicaments. Au plus fort de la crise, les médicaments antirétroviraux brevetés étaient prohibitifs pour la plupart des PRFI, en particulier en Afrique subsaharienne, où l’épidémie était la plus grave. Le prix des traitements salvateurs les met hors de portée de millions de personnes.
En réponse, la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique a été adoptée en 2001. Cette déclaration affirmait que les ADPIC « peuvent et doivent être interprétés et mis en œuvre de manière à soutenir le droit des membres de l’OMC à protéger la santé publique ». Il a souligné l’utilisation de la licence obligatoire comme outil pour élargir l’accès aux médicaments essentiels en cas d’urgence sanitaire.
À la suite de la Déclaration de Doha, plusieurs pays, dont la Thaïlande et le Brésil, ont émis des licences obligatoires pour produire des versions génériques de médicaments antirétroviraux, ce qui a considérablement réduit les prix et amélioré l’accès aux traitements contre le VIH/sida. Cette expérience a démontré que les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC pouvaient être utilisées avec succès pour relever les défis sanitaires mondiaux.
Licence obligatoire pour les traitements du cancer et de l’hépatite C
Au-delà du VIH/sida, la licence obligatoire a été utilisée dans d’autres situations d’urgence sanitaire. Par exemple, l’Inde a délivré une licence obligatoire en 2012 pour Nexavar (sorafénib), un médicament anticancéreux, permettant à une entreprise locale de produire une version générique à une fraction du coût initial. De même, plusieurs pays ont envisagé ou mis en œuvre une licence obligatoire pour les traitements coûteux de l’hépatite C et d’autres maladies non transmissibles.
Défis et limites des flexibilités de l’Accord SUR LES ADPIC
Bien que les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC aient été utilisées pour répondre à certaines urgences de santé publique, elles ne sont pas sans limites. Les licences obligatoires, en particulier, peuvent être un processus long et bureaucratique, et elles font souvent l’objet de pressions politiques de la part des pays à revenu élevé et des sociétés pharmaceutiques. En outre, les licences obligatoires sont généralement délivrées au cas par cas, ce qui limite leur utilité pour faire face à des urgences sanitaires mondiales généralisées comme la Covid-19.
De plus, bon nombre des nouveaux médicaments biologiques, y compris les vaccins, sont plus complexes à produire que les médicaments à petites molécules. Même avec une licence obligatoire, les fabricants peuvent ne pas avoir l’expertise technique ou l’accès aux matières premières nécessaires pour produire ces médicaments efficacement.
La voie à suivre : le statut des discussions sur la renonciation à l’Accord sur les ADPIC
En 2024, les discussions sur la renonciation aux ADPIC se poursuivent, sans qu’un consensus n’ait encore été atteint entre les membres de l’OMC. Bien que la dérogation bénéficie d’un large soutien de la part des PRFI et de plusieurs organisations internationales, de nombreux pays à revenu élevé et sociétés pharmaceutiques restent opposés. Les négociations en cours reflètent le débat mondial plus large sur la meilleure façon d’équilibrer la protection de la propriété intellectuelle avec les besoins de santé publique en temps de crise.
Le résultat de ces discussions aura des implications profondes pour l’avenir de la santé mondiale et de l’industrie pharmaceutique. Si la dérogation est adoptée, elle pourrait créer un précédent pour les futures pandémies et les urgences sanitaires mondiales, ce qui pourrait conduire à des interprétations plus souples des protections de la propriété intellectuelle dans le contexte de la santé publique. Cependant, si la dérogation est rejetée, le système actuel de propriété intellectuelle pourrait rester largement inchangé, les défenseurs de la santé publique continuant à faire pression pour des réformes par d’autres moyens.
Ce chapitre a exploré les origines, les implications et les débats en cours autour de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC et de la dérogation proposée pour les vaccins et les traitements contre la Covid-19. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur des études de cas spécifiques qui illustrent l’impact pratique de la protection de la propriété intellectuelle sur l’accès mondial aux médicaments et examinerons des solutions potentielles pour équilibrer l’innovation avec le droit à la santé.