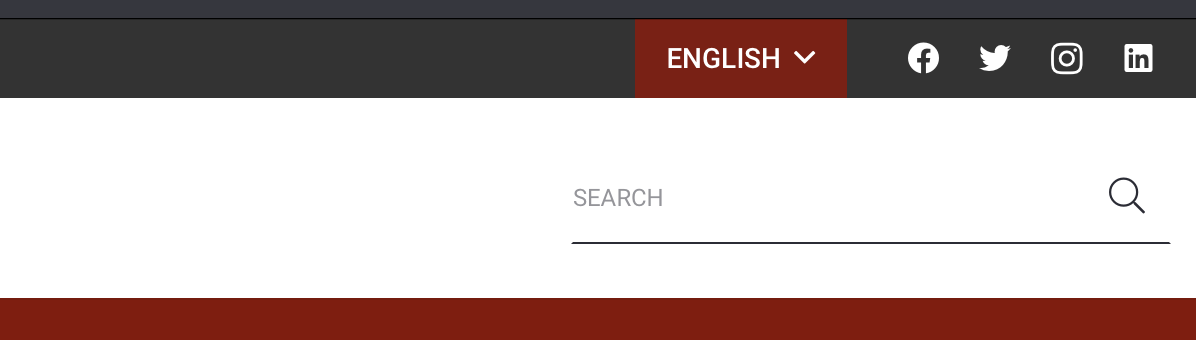Dans ce chapitre, nous explorerons plusieurs études de cas réelles qui mettent en évidence la tension entre la protection de la propriété intellectuelle (PI) et l’accès à des médicaments vitaux. Ces études de cas offrent une perspective nuancée sur la façon dont les lois sur les brevets, les accords internationaux tels que l’Accord sur les ADPIC de l’OMC et d’autres droits de propriété intellectuelle influent sur les résultats en matière de santé mondiale.
Les cas incluent la crise du VIH/sida, le développement et la distribution de vaccins contre le Covid-19 et les complexités entourant les médicaments biologiques. Ces exemples illustrent à la fois les succès et les limites du système actuel, fournissant une base pour discuter des réformes potentielles dans les chapitres ultérieurs.
Étude de cas 1 : Médicaments contre le VIH/sida et la Déclaration de Doha
La crise du VIH/sida de la fin du XXe siècle a marqué un tournant dans la discussion mondiale sur l’accès aux médicaments, en particulier dans les PRFI. Au plus fort de la crise, les traitements antirétroviraux (ARV), qui pourraient prolonger considérablement la vie des personnes vivant avec le VIH/sida, coûtaient environ 10 000 $ par patient et par an. Ce coût était prohibitif pour la majorité des patients dans les PRFI, en particulier en Afrique subsaharienne, où l’épidémie était la plus grave. Cette étude de cas illustre comment la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique a permis l’utilisation de licences obligatoires pour élargir l’accès aux médicaments vitaux.
Le rôle des brevets dans la crise du VIH/sida
Au début de la crise, les multinationales pharmaceutiques détenaient des brevets sur les thérapies ARV les plus efficaces. Alors que la crise s’aggravait, les défenseurs de la santé publique ont critiqué les prix élevés de ces médicaments, faisant valoir que les protections par brevet empêchaient des millions de personnes d’accéder à des traitements vitaux. En réponse à la pression croissante de la société civile, des gouvernements et des organisations internationales, l’OMC a convoqué une réunion en 2001 qui a conduit à l’adoption de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique.
La Déclaration de Doha a précisé que les membres de l’OMC ont le droit d’utiliser les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, y compris les licences obligatoires, pour protéger la santé publique. Il a souligné que l’Accord sur les ADPIC ne devrait pas empêcher les pays de prendre des mesures pour assurer l’accès aux médicaments dans les situations d’urgence de santé publique. La Déclaration a marqué une victoire significative pour les défenseurs de la santé publique et les PRFI qui cherchent à produire ou à importer des versions génériques moins chères d’ARV brevetés.
Licence obligatoire en pratique
À la suite de la Déclaration de Doha, plusieurs pays, dont le Brésil et la Thaïlande, ont délivré des licences obligatoires pour produire ou importer des ARV génériques. Cela a considérablement réduit le coût du traitement et élargi l’accès à des millions de personnes vivant avec le VIH/sida. Par exemple, la politique de licence obligatoire du Brésil a permis au gouvernement de négocier des prix nettement inférieurs pour les ARV, ce qui a contribué au succès du programme de traitement du VIH/sida du pays.
De plus, les sociétés pharmaceutiques ont commencé à répondre à la pression en offrant des réductions sur les ARV brevetés ou en concluant des accords de licence volontaires avec les fabricants de génériques. Le prix des ARV est passé de 10 000 $ par patient et par an à la fin des années 1990 à moins de 100 $ par patient et par an au milieu des années 2000, augmentant considérablement l’accès au traitement.
Enseignements tirés
La crise du VIH/sida a démontré le pouvoir des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, telles que l’octroi de licences obligatoires, pour élargir l’accès aux médicaments essentiels dans les situations d’urgence de santé publique. Cependant, il a également souligné les limites de cette approche. Le processus de délivrance des licences obligatoires peut être lent et bureaucratique, nécessitant souvent des négociations avec les titulaires de brevets, ce qui peut retarder l’accès aux traitements nécessaires de toute urgence. En outre, les sociétés pharmaceutiques et les pays à revenu élevé, tels que les États-Unis et les membres de l’Union européenne, ont parfois exercé une pression politique sur les pays qui tentent d’utiliser les licences obligatoires, ce qui complique encore le processus.
Étude de cas 2 : Les vaccins contre la Covid-19 et la proposition de dérogation à l’Accord sur les ADPIC
La pandémie de Covid-19 a présenté des défis sans précédent pour la santé publique mondiale et a exposé d’importantes inégalités dans la distribution des vaccins et des traitements. Alors que les vaccins ont été développés en un temps record, en partie grâce à des technologies innovantes comme l’ARNm, l’accès à ces vaccins était très inégal. Les pays à revenu élevé ont pu sécuriser l’essentiel des approvisionnements précoces en vaccins grâce à des accords d’achat anticipé, laissant de nombreux PRFI sans doses suffisantes. Cette étude de cas examine l’impact de la protection de la propriété intellectuelle sur la distribution du vaccin contre la Covid-19 et le débat en cours sur la proposition de dérogation à l’Accord sur les ADPIC.
Le développement de vaccins contre la Covid-19
Le développement rapide des vaccins contre la Covid-19 a été une réalisation scientifique remarquable, tirée par les investissements des secteurs public et privé. Cependant, la distribution initiale de ces vaccins a été marquée par de fortes inégalités. À la mi-2021, les pays à revenu élevé avaient administré la majorité des doses disponibles, tandis que de nombreux PRFI avaient du mal à vacciner même une petite partie de leur population. Cette disparité était en partie due aux protections par brevet des vaccins contre la Covid-19, qui limitaient la capacité des PRFI à produire leurs propres doses ou à s’approvisionner auprès de fournisseurs alternatifs.
La proposition d’exemption de l’Accord sur les ADPIC
En réponse à la distribution inéquitable des vaccins, l’Inde et l’Afrique du Sud ont proposé une dérogation temporaire à certaines dispositions de l’Accord sur les ADPIC en octobre 2020. La dérogation visait à permettre aux États membres de l’OMC de suspendre les protections de propriété intellectuelle pour les vaccins, les traitements et les diagnostics contre la Covid-19 pendant la durée de la pandémie. Les partisans de la dérogation ont fait valoir qu’elle éliminerait les obstacles juridiques à la fabrication locale de vaccins et de traitements, en particulier dans les PRFI, augmentant ainsi l’offre mondiale et accélérant la fin de la pandémie.
Cependant, la proposition de dérogation a rencontré une forte opposition de plusieurs pays à revenu élevé, dont les États-Unis (initialement), l’Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi que de grandes sociétés pharmaceutiques. Les opposants ont fait valoir que la dérogation saperait les incitations à l’innovation et que les véritables obstacles à la distribution des vaccins étaient liés aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et de capacité de fabrication, et non à la propriété intellectuelle.
COVAX et les défis de la distribution équitable
L’initiative COVAX, codirigée par GAVI, l’Alliance pour les vaccins, l’OMS et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), a été conçue pour assurer un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19, en particulier pour les PFR-PRI. Bien que COVAX ait réussi à fournir des vaccins à de nombreux pays, elle a été confrontée à des défis importants, notamment un financement insuffisant et des pénuries d’approvisionnement, ce qui a entravé sa capacité à répondre à la demande mondiale.
LANCEMENT DU PLAN DE VACCINATION ANTI-COVID-19
Le cas du vaccin Covid-19 met en évidence la relation complexe entre la propriété intellectuelle, la santé mondiale et la capacité de fabrication. Bien que la protection par brevet n’ait pas créé le seul obstacle à l’accès aux vaccins, elle a contribué aux inégalités en limitant la capacité des PRFI à produire leurs propres vaccins. De plus, le débat sur la dérogation aux ADPIC a révélé les limites du système de propriété intellectuelle existant pour répondre aux urgences sanitaires mondiales. La proposition de dérogation reste une question controversée, avec des négociations en cours au sein de l’OMC, et son résultat aura des implications importantes pour les pandémies futures.
Étude de cas 3 : Médicaments biologiques et épais brevets
Les médicaments biologiques, qui sont dérivés d’organismes vivants, représentent certains des traitements les plus avancés et les plus coûteux disponibles aujourd’hui. Ces médicaments sont utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer, les maladies auto-immunes et les troubles génétiques. Cependant, le paysage des brevets pour les produits biologiques est beaucoup plus complexe que pour les médicaments traditionnels à petites molécules, ce qui crée des obstacles supplémentaires à la production de biosimilaires abordables (versions génériques des produits biologiques). Cette étude de cas explore comment les fourrés de brevets ont été utilisés pour étendre l’exclusivité commerciale des médicaments biologiques, prévenir la concurrence et augmenter les coûts.
L’essor des médicaments biologiques
Les médicaments biologiques ont révolutionné le traitement de nombreuses maladies graves, offrant des thérapies ciblées qui peuvent être plus efficaces que les traitements traditionnels. Cependant, les produits biologiques sont beaucoup plus coûteux à développer et à produire, ce qui se reflète dans leurs prix sur le marché. Par exemple, Humira (adalimumab), un produit biologique utilisé pour traiter des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, a été l’un des médicaments les plus vendus au monde, mais son coût peut dépasser 50 000 $ par patient et par an aux États-Unis.
Brevets épais et conifères
Pour protéger leur exclusivité commerciale, les sociétés pharmaceutiques déposent souvent plusieurs brevets sur divers aspects d’un médicament biologique, une pratique connue sous le nom de evergreening. Ces brevets secondaires peuvent couvrir de nouvelles formulations, des schémas posologiques, des mécanismes d’administration ou même de légères modifications dans le processus de fabrication. Le résultat est un fourré de brevets, un réseau dense de brevets qui se chevauchent et qui peuvent prolonger l’exclusivité au-delà de la durée du brevet initial de 20 ans.
Par exemple, AbbVie, le fabricant d’Humira, a déposé plus de 100 brevets sur le médicament aux États-Unis, retardant ainsi l’entrée de concurrents biosimilaires au moins jusqu’en 2023, même si le brevet original a expiré en 2016. Cette exclusivité étendue a permis à AbbVie de continuer à facturer des prix élevés, limitant l’accès au médicament pour les patients des PRFI et augmentant les coûts des soins de santé dans les pays à revenu élevé.
Barrières à la concurrence
Même lorsque les fabricants de biosimilaires parviennent à naviguer dans les fourrés de brevets, le processus de développement et d’approbation réglementaire des biosimilaires est beaucoup plus complexe que pour les génériques à petites molécules. Les médicaments biologiques sont de grandes molécules complexes qui sont plus difficiles à reproduire, et les biosimilaires doivent subir des tests rigoureux pour démontrer qu’ils sont suffisamment similaires au produit biologique d’origine. Cette complexité, combinée aux défis juridiques posés par les fourrés de brevets, a retardé l’introduction des biosimilaires et maintenu les prix élevés.
Leçons tirées des produits biologiques
Le cas des médicaments biologiques et des fourrés de brevets démontre comment le système de propriété intellectuelle actuel peut être manipulé pour étendre l’exclusivité du marché, créant des obstacles importants à la concurrence et à l’accès à des traitements abordables. Il souligne la nécessité de réformer la manière dont les brevets sont délivrés et appliqués, en particulier pour les produits biologiques, où les implications pour la santé publique du retard d’accès sont profondes.
Résumé des implications pratiques
Les études de cas présentées dans ce chapitre illustrent l’impact pratique de la protection par brevet sur la santé mondiale. Bien que les brevets jouent un rôle crucial dans l’incitation à l’innovation, ils peuvent également créer des obstacles importants à l’accès, en particulier dans les PRFI. La crise du VIH/sida a montré le potentiel des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, comme l’octroi de licences obligatoires, pour élargir l’accès aux médicaments vitaux, mais a également révélé les limites de ces mécanismes dans la pratique. La pandémie de Covid-19 a exposé les limites du système mondial de propriété intellectuelle dans sa réponse aux crises sanitaires urgentes et a souligné la nécessité de solutions plus flexibles et équitables. Enfin, le cas des médicaments biologiques et des fourrés de brevets démontre comment l’utilisation stratégique des brevets peut étendre l’exclusivité commerciale, retardant l’accès à des traitements abordables.
Dans le prochain chapitre, nous explorerons les perspectives juridiques et éthiques sur l’équilibre entre l’innovation pharmaceutique et le droit mondial à la santé, et proposerons des réformes potentielles du système existant pour mieux relever les défis sanitaires mondiaux.