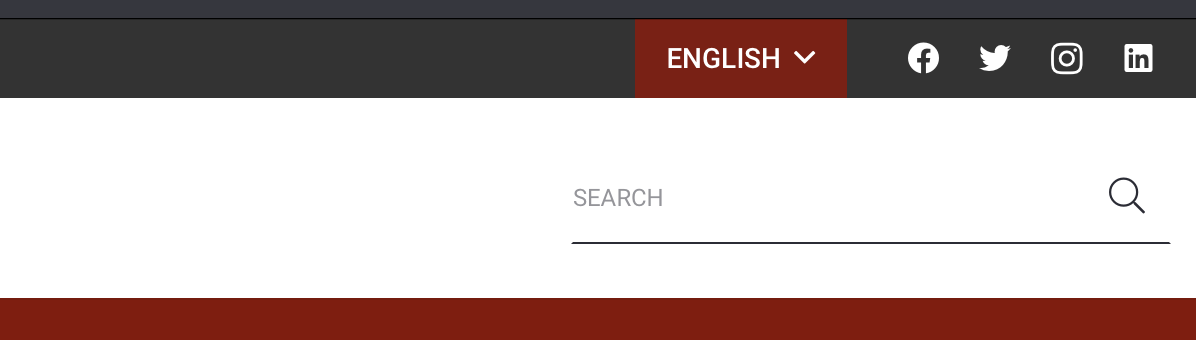Le rôle des brevets dans l’industrie pharmaceutique
Les brevets pharmaceutiques sont une pierre angulaire de l’écosystème de l’innovation, fournissant des incitations essentielles aux entreprises pour investir dans le processus coûteux et fastidieux de développement de médicaments. La mise sur le marché d’un produit pharmaceutique moyen prend plus d’une décennie et est estimée à 2,6 milliards de dollars, de la découverte initiale à l’approbation réglementaire. Sans la protection des brevets, il serait difficile pour les entreprises de récupérer ces investissements, car les concurrents pourraient facilement produire et vendre des versions génériques d’un médicament nouvellement développé à une fraction du coût.
Les brevets confèrent un monopole temporaire, qui dure généralement 20 ans à compter de la date de dépôt, pendant lequel le titulaire du brevet a le droit exclusif de produire, de commercialiser et de vendre le médicament. Cette exclusivité permet à l’entreprise de fixer des prix qui reflètent à la fois les dépenses de R&D et le risque d’échec (étant donné que la plupart des candidats médicaments ne passent pas par les essais cliniques). Les bénéfices qui en résultent financent l’innovation future et compensent le taux d’attrition élevé de la recherche pharmaceutique.
Le système des brevets, bien qu’essentiel pour les sociétés pharmaceutiques, n’est pas sans critiques. Les critiques soutiennent que les brevets peuvent entraîner une inflation des prix des médicaments, rendant les médicaments essentiels inaccessibles à beaucoup, en particulier dans les PRFI. Les prix élevés des médicaments, tels que ceux observés avec les traitements contre le VIH/sida dans les années 1990 ou plus récemment avec les thérapies anticancéreuses et les médicaments biologiques, soulignent la tension entre la protection de l’innovation et la garantie de la santé publique.
Droit d’auteur et brevets : comprendre les droits de propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique
Bien que le droit d’auteur et les brevets soient des formes de protection de la propriété intellectuelle (PI), ils servent des objectifs distincts, en particulier dans l’industrie pharmaceutique. Le droit d’auteur protège principalement les œuvres créatives, telles que les livres, les films et les logiciels, en accordant au créateur des droits exclusifs de reproduction, de distribution et d’affichage de l’œuvre. En revanche, les brevets protègent les inventions, y compris les nouveaux médicaments, les procédés de fabrication et les dispositifs médicaux.
Pour les sociétés pharmaceutiques, les brevets sont beaucoup plus critiques que les droits d’auteur. Un nouveau médicament est généralement le résultat d’années d’expérimentation, de tests et de développement, ce qui rend la protection par brevet cruciale pour récupérer les coûts de l’innovation. Les brevets couvrent la composition d’un médicament, son mode d’utilisation et son procédé de fabrication. Dans certains cas, des brevets secondaires peuvent être déposés pour étendre l’exclusivité commerciale, par exemple, en brevetant une nouvelle formulation ou une nouvelle méthode d’administration d’un médicament existant.
Les différences entre les brevets et les droits d’auteur reflètent la nature de l’innovation pharmaceutique, qui concerne davantage la découverte scientifique que l’expression créative. Bien que les droits d’auteur puissent s’appliquer aux rapports d’études cliniques, aux publications de recherche ou aux documents de marketing, les brevets protègent l’innovation de base dans le développement de médicaments, protégeant la molécule ou le traitement qui a une valeur thérapeutique.
Industries pharmaceutiques
L’industrie pharmaceutique est un environnement hautement complexe et concurrentiel, dominé par deux grands types d’entreprises : les grandes sociétés multinationales, souvent appelées « Big Pharma », et les petites entreprises de biotechnologie. Les deux dépendent fortement des brevets pour survivre et prospérer, bien que leurs approches en matière d’innovation et de protection de la propriété intellectuelle puissent différer considérablement.
- Grandes sociétés pharmaceutiques et stratégies en matière de brevets : Les grandes sociétés pharmaceutiques gèrent généralement de vastes portefeuilles de brevets pour protéger leurs découvertes et contrôler leurs parts de marché. Ils investissent massivement dans la R&D, avec des revenus dépassant souvent des milliards de dollars par an, et comptent sur la protection des brevets pour générer des retours sur cet investissement. Des entreprises comme Pfizer, Merck et Johnson & Johnson sont d’excellents exemples de grandes entreprises pharmaceutiques qui utilisent la protection par brevet pour protéger les médicaments à succès. – Les produits qui génèrent des ventes annuelles de plus de 1 milliard de dollars. Big Pharma utilise souvent des fourrés de brevets, qui impliquent le dépôt de nombreux brevets autour d’un seul médicament, pour étendre l’exclusivité du marché et bloquer la concurrence des génériques.
- Startups biotechnologiques et capital-risque : Les petites entreprises de biotechnologie dépendent également des brevets, mais pour des raisons différentes. Pour de nombreuses startups, les brevets sont essentiels pour attirer des fonds de capital-risque. Ces entreprises se concentrent souvent sur la recherche à un stade précoce, comme le développement de nouvelles cibles de médicaments ou de systèmes de distribution, puis s’appuient sur des partenariats ou des acquisitions par de plus grandes entreprises pour commercialiser leurs produits. Sans une forte protection par brevet, les startups biotechnologiques auraient du mal à obtenir les investissements nécessaires pour développer de nouvelles thérapies, car les investisseurs potentiels seraient préoccupés par le risque d’imitation par leurs concurrents.
Les deux types d’entreprises sont essentiels à l’écosystème de l’innovation pharmaceutique. Big Pharma a les ressources nécessaires pour prendre des médicaments à travers le processus d’approbation réglementaire long et coûteux, tandis que les entreprises de biotechnologie ouvrent souvent la voie à la recherche et au développement à un stade précoce. Ensemble, ils forment une relation symbiotique qui stimule l’innovation pharmaceutique.
Le processus de développement de médicaments et les délais de brevet
Le processus de développement d’un médicament est notoirement long, avec plusieurs étapes clés qui contribuent au coût global et au temps nécessaire pour mettre un nouveau médicament sur le marché. Ces étapes comprennent :
- Découverte et recherche préclinique : les chercheurs identifient les cibles potentielles des médicaments (telles que les protéines ou les gènes impliqués dans une maladie) et effectuent des tests de laboratoire pour évaluer leurs effets. Cette phase peut prendre plusieurs années et est souvent la plus incertaine, car de nombreux candidats-médicaments ne se montrent pas prometteurs lors des premiers tests.
- Essais cliniques (phases I à III) : une fois qu’un médicament présente un potentiel dans la recherche préclinique, il entre dans des essais cliniques, qui impliquent de tester le médicament sur des humains. Les essais cliniques sont divisés en trois phases (chaque phase peut durer plusieurs années et les médicaments peuvent échouer à tout moment) :
- Phase I : Teste l’innocuité du médicament dans un petit groupe de volontaires en bonne santé.
- Phase II : Évalue l’efficacité du médicament chez un plus grand groupe de patients atteints de la maladie cible.
- Phase III : Effectue des tests à grande échelle pour confirmer l’efficacité et surveiller les effets secondaires.
- Examen et approbation réglementaires : Après des essais cliniques réussis, le médicament est soumis à des organismes de réglementation (tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou l’Agence européenne des médicaments (EMA)) pour approbation. Ce processus peut prendre des années supplémentaires à mesure que les régulateurs examinent les données pour en vérifier l’innocuité, l’efficacité et la qualité de fabrication.
- Après l’approbation et la commercialisation : une fois approuvé, le médicament entre sur le marché, où il est généralement protégé par des brevets pour le reste de la période de 20 ans. Cependant, en raison de la longueur du processus de développement, l’horloge du brevet commence à tourner bien avant que le médicament n’atteigne le marché, laissant la plupart des médicaments avec seulement 7 à 12 ans d’exclusivité commerciale effective.
Au cours de la période post-approbation, les entreprises s’engagent souvent dans la commercialisation et peuvent poursuivre des brevets secondaires sur différentes formulations, combinaisons ou utilisations du médicament pour prolonger la période d’exclusivité au-delà de l’expiration du brevet original.
Les brevets comme épée à double tranchant : encourager l’innovation et limiter l’accès
Si les brevets sont essentiels pour encourager l’innovation pharmaceutique, ils créent également des défis en termes d’accès mondial aux médicaments. Les médicaments brevetés sont souvent hors de portée pour beaucoup dans les pays en développement, où les systèmes de santé publique sont sous-financés et les patients n’ont pas la capacité de payer des prix élevés pour les traitements. Cette disparité est devenue particulièrement évidente lors de la crise du VIH/sida de la fin du XXe siècle, lorsque les médicaments antirétroviraux étaient disponibles dans les pays à revenu élevé mais inaccessibles à des millions de patients dans les PRFI.
Pour résoudre ce problème, les accords internationaux, tels que la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (2001), ont cherché à fournir une certaine flexibilité dans l’application des brevets, permettant aux pays de délivrer des licences obligatoires en cas d’urgence de santé publique. Une licence obligatoire permet à un gouvernement d’autoriser la production d’un médicament breveté sans le consentement du titulaire du brevet, généralement en échange d’une redevance. Ce mécanisme a été utilisé avec succès pour élargir l’accès à des traitements vitaux dans certaines circonstances, mais son application reste controversée, de nombreux pays développés et sociétés pharmaceutiques le considérant comme une violation des droits de propriété intellectuelle.
De plus, la pandémie de Covid-19 a attiré à nouveau l’attention sur les limites du système des brevets, notamment en termes d’accès aux vaccins. Bien que la protection par brevet ait encouragé le développement rapide des vaccins contre le Covid-19, elle a également suscité des inquiétudes quant à la distribution inégale, les pays à revenu élevé assurant la majeure partie des approvisionnements en vaccins précoces, laissant de nombreux PFR-PRI derrière eux.
Italie avant 1978 – Sans brevets pour les inventions pharmaceutiques
En Italie, la protection par brevet des produits pharmaceutiques n’est devenue disponible qu’en 1978. A cette époque, la Cour constitutionnelle (20/03/1978 n ° 20) a prononcé l’inconstitutionnalité de l’art. 14 du R.D. 29/06/1939, n ° 1127 (la loi sur les inventions industrielles) qui interdisait la délivrance de brevets aux inventions pharmaceutiques, sur le fondement de certaines justifications « morales ». La Cour suprême s’est prononcée en faveur de dix-huit sociétés pharmaceutiques, toutes étrangères, demandant l’application de brevets étrangers sur des produits médicaux en Italie. Mais étonnamment, malgré cette absence totale de protection par brevet, l’Italie avait développé une industrie pharmaceutique forte : à la fin des années 1970, elle était le cinquième producteur mondial de produits pharmaceutiques et le septième exportateur [1].
Les dépenses de R&D pharmaceutique en Italie sont passées de 123 milliards de lires en 1978 à 1 632 milliards de lires en 1992, passant de 7,78% du chiffre d’affaires à 11,99% [2]. Les nouveaux produits pharmaceutiques d’origine italienne commercialisés entre 1975 et 1989 représentaient 9,2% du total mondial de 775, tandis que ceux définis comme « d’innovation thérapeutique substantielle » sont passés de 1,25% du total mondial en 1975-79 à 2,78% en 1980-84 et à 3,9% au cours de la période 1985-89.
Mais des preuves solides que la concentration et la protection par brevet vont de pair proviennent de l’expérience italienne avant et après le tournant de 1978. Avant 1978, l’industrie pharmaceutique italienne se caractérisait par la présence d’un grand nombre de petites et moyennes entreprises indépendantes. Après 1978, la concentration de l’industrie a progressé rapidement : le nombre total d’entreprises indépendantes est passé de 464 en 1976 à 390 en 1980 et à 335 en 1985. Au cours de la même période, aucune concentration de l’activité productive n’a eu lieu dans l’industrie pharmaceutique des autres grands pays occidentaux. L’industrie pharmaceutique italienne, quant à elle, a perdu des parts de marché à un rythme constant tant au niveau national que mondial [3]. Une conclusion peut être tirée : les brevets dans le secteur de la santé sont susceptibles de favoriser les grandes structures industrielles. En ce qui concerne les marchés plus petits qu’aux États-Unis, il est beaucoup question de savoir si l’impact économique des brevets dans les sciences de la vie et leur rôle dans la stimulation de l’innovation et l’attraction des investissements de l’industrie dans la R&D médicale sont susceptibles d’avoir des effets positifs ou non [4].