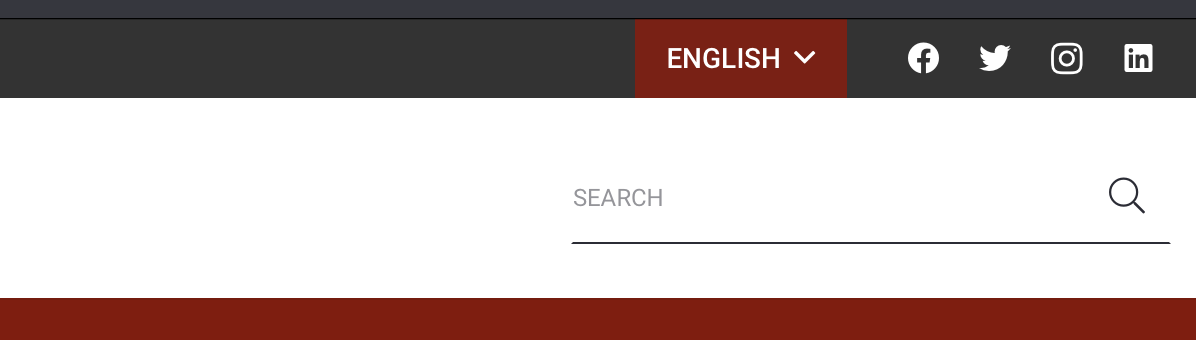Ce chapitre se penche sur les perspectives juridiques et éthiques entourant la relation complexe entre l’innovation pharmaceutique, les droits de propriété intellectuelle (PI) et le droit mondial à la santé. Bien que les brevets et d’autres formes de protection de la propriété intellectuelle soient essentiels pour favoriser l’innovation dans l’industrie pharmaceutique, ils créent souvent des obstacles à l’accès aux médicaments vitaux, en particulier dans les PRFI. Trouver un équilibre entre la nécessité d’encourager l’innovation et d’assurer l’accès mondial aux médicaments essentiels est l’un des défis les plus urgents de la politique de santé mondiale contemporaine. Ce chapitre explorera les responsabilités éthiques des sociétés pharmaceutiques, le rôle des gouvernements et des organisations internationales, ainsi que d’autres modèles de propriété intellectuelle visant à équilibrer ces intérêts concurrents.
La responsabilité éthique des entreprises pharmaceutiques
Les sociétés pharmaceutiques jouent un rôle central dans l’écosystème mondial de la santé. Ils sont responsables du développement de nouveaux traitements et remèdes qui sauvent des millions de vies chaque année. Cependant, ces entreprises sont également des entités axées sur le profit, et leur obligation principale est souvent considérée comme une maximisation de la valeur pour les actionnaires. Cette tension entre les motivations de profit des entreprises et les besoins de santé publique plus larges soulève d’importantes questions éthiques sur le rôle des sociétés pharmaceutiques dans la société.
Bénéfice vs bien public
Les sociétés pharmaceutiques soutiennent que les coûts élevés du développement de médicaments, en particulier pour les thérapies innovantes, nécessitent de solides protections par brevet et des modèles de tarification premium. Sans la perspective de rendements financiers importants, les entreprises seraient réticentes à investir les milliards de dollars nécessaires pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché, en particulier compte tenu des risques élevés d’échec dans le développement de médicaments. Cet argument, souvent appelé « incitation à l’innovation », est le fondement du système de brevets pharmaceutiques.
Cependant, les critiques soutiennent que cette focalisation sur le profit peut parfois se faire au détriment du bien public, en particulier lorsqu’il s’agit d’accéder à des médicaments vitaux. Les prix élevés des médicaments brevetés les rendent souvent inaccessibles aux patients des PRFI, où les systèmes de santé sont sous-financés et où les paiements directs pour les médicaments sont courants. Cela soulève des questions éthiques quant à savoir si les sociétés pharmaceutiques ont l’obligation morale de donner la priorité à l’accès aux médicaments plutôt qu’à la maximisation des profits, en particulier en cas d’urgence sanitaire mondiale.
Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et accès aux médicaments
Ces dernières années, le concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) a gagné du terrain au sein de l’industrie pharmaceutique. La RSE fait référence à l’idée que les entreprises doivent agir de manière éthique et contribuer au bien-être de la société au-delà de leurs obligations financières et légales. Pour les entreprises pharmaceutiques, la RSE implique souvent des initiatives visant à améliorer l’accès aux médicaments, en particulier dans les PRFI. Ces initiatives comprennent :
- Accords de licence volontaire : certaines sociétés pharmaceutiques ont conclu des accords de licence volontaire avec des fabricants de génériques, leur permettant de produire des versions moins chères de médicaments brevetés pour distribution dans les PRFI. Ces accords ont été particulièrement importants pour élargir l’accès aux traitements contre le VIH/sida et, plus récemment, à certains traitements contre la Covid-19.
- Tarification différentielle : La tarification différentielle est une stratégie dans laquelle les sociétés pharmaceutiques facturent des prix plus bas pour les médicaments brevetés dans les PRFI que dans les pays à revenu élevé. Bien que cette approche puisse améliorer l’accès aux médicaments dans les pays les plus pauvres, elle n’est pas sans controverse, car les structures de prix peuvent encore laisser de nombreux médicaments essentiels inabordables pour les populations les plus pauvres.
- Programmes philanthropiques : certaines sociétés pharmaceutiques ont mis en place des programmes philanthropiques pour donner ou subventionner des médicaments pour les populations dans le besoin. Bien que ces programmes puissent avoir un impact positif, les critiques affirment qu’ils ont souvent une portée limitée et ne traitent pas des problèmes structurels sous-jacents liés à la protection par brevet et à l’accès aux médicaments.
Bien que les initiatives de RSE soient un pas dans la bonne direction, de nombreux défenseurs de la santé publique affirment qu’elles ne sont pas suffisantes pour relever les défis éthiques plus profonds posés par le système des brevets. Ils soutiennent que les sociétés pharmaceutiques, compte tenu de leur rôle central dans la santé mondiale, ont une responsabilité éthique plus large de veiller à ce que les médicaments vitaux soient accessibles à tous, quelle que soit leur capacité de payer.
Rôle des gouvernements et des organisations internationales
Les gouvernements et les organisations internationales jouent également un rôle crucial dans l’équilibre entre l’innovation pharmaceutique et l’accès aux médicaments. Alors que les sociétés pharmaceutiques développent et commercialisent de nouveaux médicaments, les gouvernements sont responsables de réglementer ces sociétés et de veiller à ce que les besoins de santé publique soient satisfaits. Au niveau international, des organisations telles que l’OMS, l’OMC et les Nations Unies (ONU) façonnent les cadres mondiaux qui régissent les brevets pharmaceutiques et l’accès aux médicaments.
La réglementation gouvernementale et l’impératif de santé publique
Les gouvernements disposent de plusieurs outils pour réglementer l’industrie pharmaceutique et assurer l’accès aux médicaments. Ces outils comprennent ce qui suit:
- Contrôles des prix : certains gouvernements, en particulier en Europe, réglementent les prix des médicaments pour s’assurer qu’ils sont abordables pour leurs populations. Cependant, le contrôle des prix peut être controversé, car les sociétés pharmaceutiques affirment qu’elles réduisent les incitations à l’innovation en limitant les retours potentiels sur investissement.
- Licence obligatoire : Comme indiqué dans les chapitres précédents, la licence obligatoire permet aux gouvernements d’autoriser la production de versions génériques de médicaments brevetés sans le consentement du titulaire du brevet, généralement en échange d’une redevance. Bien que la licence obligatoire soit un outil important pour élargir l’accès aux médicaments dans les situations d’urgence de santé publique, elle est souvent combattue par les sociétés pharmaceutiques et les pays à revenu élevé, qui affirment qu’elle sape le système mondial des brevets.
- Financement public de la recherche et du développement (R&D) : les gouvernements peuvent également jouer un rôle proactif dans le financement de la R&D pharmaceutique, en particulier pour les maladies qui touchent principalement les PFR-PRI et qui sont souvent négligées par le secteur privé. La R&D financée par des fonds publics peut aider à garantir que de nouveaux traitements sont développés en réponse aux besoins de santé publique plutôt qu’à la demande du marché, et peut conduire à des médicaments plus abordables.
Collaborations internationales et en santé mondiale
Au niveau international, des organisations telles que l’OMS et l’OMC jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des cadres qui régissent les brevets pharmaceutiques et l’accès aux médicaments. L’Accord sur les ADPIC de l’OMC établit les règles mondiales pour la protection de la propriété intellectuelle, tandis que l’OMS veille à ce que la santé publique reste une priorité dans la gouvernance mondiale.
- Le rôle de l’OMS dans la promotion de l’accès aux médicaments : L’OMS plaide depuis longtemps en faveur de politiques QUI donnent la priorité à l’accès aux médicaments essentiels, en particulier dans les PRFI. La Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée en 2001, a été une victoire importante pour les défenseurs de la santé publique, car elle a affirmé que les pays devraient pouvoir utiliser les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC pour assurer l’accès aux médicaments dans les situations d’urgence de santé publique. Plus récemment, l’OMS a joué un rôle clé dans la promotion de l’équité mondiale en matière de vaccins pendant la pandémie de Covid-19, grâce à des initiatives telles que COVAX.
- Le rôle de l’OMC dans l’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la santé publique : l’Accord sur les ADPIC de l’OMC est l’un des accords internationaux les plus importants régissant les brevets pharmaceutiques. Bien que l’Accord sur les ADPIC ait été conçu pour promouvoir l’innovation en offrant de solides protections de la propriété intellectuelle, il a été critiqué pour avoir créé des obstacles à l’accès aux médicaments dans les PRFI. Les discussions en cours autour de la proposition de dérogation à l’Accord sur les ADPIC pour les vaccins contre la Covid-19 mettent en évidence les défis de l’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et le droit mondial à la santé.
Les gouvernements et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour s’assurer que le système mondial de propriété intellectuelle est suffisamment flexible pour répondre aux urgences de santé publique tout en encourageant l’innovation. Cela nécessite un équilibre délicat, car des protections de propriété intellectuelle trop rigides peuvent exacerber les inégalités mondiales en matière de santé, tandis que des exceptions trop larges aux protections de propriété intellectuelle peuvent saper les incitations à l’innovation future.
Licences humanitaires et approches open source des produits pharmaceutiques
À la lumière des défis posés par le système actuel de propriété intellectuelle, des modèles alternatifs pour encourager l’innovation pharmaceutique et élargir l’accès aux médicaments ont suscité une attention croissante. Deux des modèles les plus prometteurs sont l’octroi de licences humanitaires et la recherche pharmaceutique open source.
Licences humanitaires
L’octroi de licences humanitaires fait référence à la pratique consistant à accorder des licences pour la production de médicaments brevetés d’une manière qui donne la priorité à l’accès des populations mal desservies. Dans le cadre de ce modèle, les titulaires de brevets peuvent permettre aux fabricants de génériques de produire et de distribuer leurs médicaments dans les PRFI, souvent à des prix réduits ou sans redevance. Cette approche permet aux sociétés pharmaceutiques de conserver leurs droits de brevet dans les pays à revenu élevé, où elles peuvent encore facturer des prix plus élevés pour récupérer les coûts de R&D, tout en veillant à ce que les médicaments essentiels soient abordables et accessibles dans les PRFI.
La licence humanitaire a été utilisée avec succès dans plusieurs cas :
- Le Medicines Patent Pool (MPP) : Le MPP, créé en 2010, travaille à accroître l’accès aux traitements du VIH, de la tuberculose (TB) et de l’hépatite C en négociant des licences volontaires avec les sociétés pharmaceutiques. Ces licences permettent aux fabricants de génériques de produire et de distribuer des versions abordables de médicaments brevetés dans les PRFI. Le MPP a joué un rôle clé dans l’élargissement de l’accès aux traitements du VIH dans de nombreux pays, et pendant la pandémie de Covid-19, il a étendu son mandat pour inclure les traitements et les technologies de la Covid-19.
Bien que l’octroi de licences humanitaires se soit avéré efficace pour élargir l’accès à certains médicaments essentiels, il repose sur la volonté des titulaires de brevets de participer. Les critiques soutiennent qu’un système plus formel et obligatoire d’octroi de licences pourrait être nécessaire pour garantir que les médicaments vitaux soient disponibles pour tous, en particulier dans le cas de futures pandémies.
Recherche dans diverses sources publiques
Le modèle open source de la recherche pharmaceutique vise à remédier aux limites du système actuel de propriété intellectuelle en promouvant la collaboration et la transparence dans le développement de médicaments. Dans le cadre de ce modèle, les chercheurs, les universités et les sociétés pharmaceutiques partagent ouvertement les données, les résultats de la recherche et les technologies, ce qui permet un développement plus rapide et plus efficace des médicaments. L’approche open source supprime les obstacles créés par les brevets, garantissant que les nouveaux traitements sont largement accessibles et abordables.
Un exemple de cette approche est le projet Open Source Malaria, qui rassemble des scientifiques du monde entier pour collaborer au développement de nouveaux traitements contre le paludisme. En partageant ouvertement leurs recherches et leurs résultats, les participants au projet espèrent accélérer la découverte de nouveaux traitements antipaludiques sans avoir besoin d’une protection par brevet.
Le modèle open source est très prometteur pour relever les défis de la santé mondiale, en particulier pour les maladies qui sont souvent négligées par le marché pharmaceutique traditionnel. Cependant, ce modèle soulève également des questions sur la façon de financer la R&D sans les incitations financières fournies par la protection par brevet. Certains partisans de la recherche open source soutiennent que le financement public, les prix et d’autres incitations non liées aux brevets peuvent être utilisés pour encourager l’innovation sans créer d’obstacles à l’accès.
L’avenir de la propriété intellectuelle et de la santé mondiale
Le système mondial de la propriété intellectuelle est à la croisée des chemins. Alors que le monde est confronté à de nouveaux défis sanitaires en constante évolution, notamment les pandémies, le changement climatique et la résistance aux antimicrobiens, il est de plus en plus nécessaire d’adopter des approches plus flexibles et équitables en matière d’innovation pharmaceutique et d’accès aux médicaments. Ce chapitre a mis en évidence plusieurs pistes potentielles, notamment l’octroi de licences humanitaires, la recherche pharmaceutique open source et l’augmentation du financement public de la R&D.
Le défi consiste à créer un système qui encourage l’innovation tout en veillant à ce que toutes les personnes, où qu’elles vivent ou combien elles gagnent, aient accès aux médicaments dont elles ont besoin pour mener une vie saine. Pour atteindre cet équilibre, il faudra une coopération entre les sociétés pharmaceutiques, les gouvernements, les organisations internationales et la société civile. Comme l’a montré la pandémie de Covid-19, la santé mondiale est une responsabilité collective, et l’avenir du système de propriété intellectuelle doit refléter cette réalité.
Dans le chapitre suivant, nous explorerons des recommandations politiques spécifiques pour réformer le système actuel et examinerons comment les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 peuvent être appliquées aux futurs défis sanitaires mondiaux.