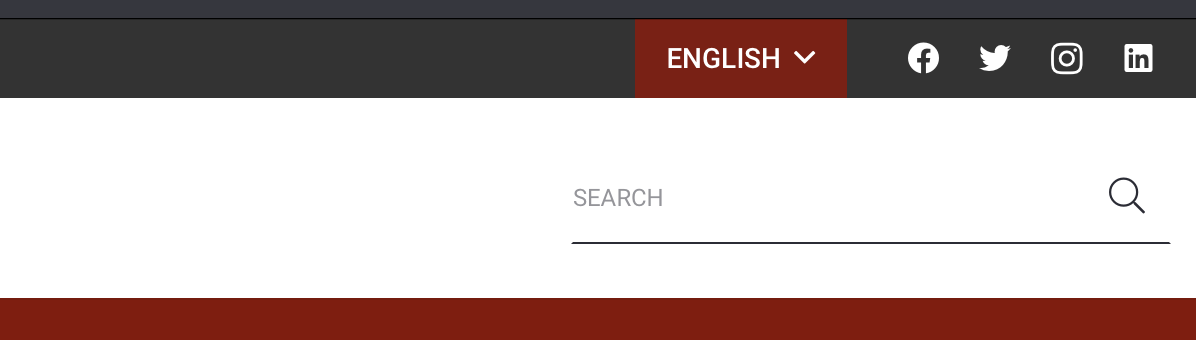Le droit à la santé est un droit humain fondamental.
Le droit à la santé est universellement reconnu comme un droit humain fondamental, consacré dans divers cadres juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). L’article 25 de la Déclaration universelle stipule que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement et les soins médicaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne en outre ce principe, affirmant que « la jouissance du meilleur état de santé possible est l’un des droits fondamentaux de tout être humain ».
Bien que ces déclarations fournissent une base morale et juridique solide pour le droit à la santé, dans la pratique, l’accès aux médicaments vitaux reste profondément inégal à travers le monde. Cette inégalité est particulièrement marquée entre les pays à revenu élevé et les PFR-PRI. Les brevets pharmaceutiques et les prix élevés des médicaments qui en résultent sont souvent considérés comme l’un des principaux obstacles à un accès équitable aux médicaments, créant une tension entre la protection de la propriété intellectuelle et les besoins de santé publique.
Accès aux médicaments essentiels
La question de l’accès aux médicaments est plus aiguë dans les PRFI, où réside la majorité de la population mondiale, mais où les systèmes de santé sont souvent sous-financés et fragmentés. Dans ces régions, les médicaments essentiels – ceux qui répondent aux besoins sanitaires prioritaires de la population – sont souvent indisponibles ou inabordables. Selon les estimations de l’OMS, environ deux milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès aux médicaments essentiels, ce qui entraîne des décès évitables dus à des maladies telles que le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et, plus récemment, la Covid-19.
Prix élevés des médicaments brevetés
L’un des principaux obstacles à l’accès est le prix élevé des médicaments brevetés. Les entreprises pharmaceutiques, en particulier dans les pays à revenu élevé, justifient ces prix en invoquant la nécessité de récupérer les coûts massifs associés à la recherche et au développement (R&D), aux essais cliniques et aux processus d’approbation réglementaire. Cependant, pour les PRFI, où les gouvernements ont souvent du mal à fournir des services de santé de base, il est souvent impossible de payer les coûts élevés des médicaments brevetés. Cela a été le cas avec plusieurs traitements vitaux :
- Antirétroviraux contre le VIH/sida : À la fin des années 1990, les médicaments antirétroviraux brevetés pour traiter le VIH/sida étaient vendus à plus de 10 000 $ par patient et par an dans les pays à revenu élevé. Ce prix était bien au-delà de la portée de la plupart des PRFI, en particulier en Afrique subsaharienne, qui ont été les plus touchés par l’épidémie de VIH/sida. Ce n’est qu’avec l’introduction de versions génériques, rendues possibles par l’octroi de licences obligatoires et d’autres flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, que les prix des antirétroviraux ont chuté de façon spectaculaire, élargissant l’accès à des millions de patients.
- Traitements du cancer : Au cours de la dernière décennie, les thérapies anticancéreuses révolutionnaires, telles que les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de kinase, ont montré une efficacité remarquable dans le traitement de cancers comme la leucémie et le cancer du poumon. Cependant, ces médicaments portent souvent des étiquettes de prix exorbitantes, avec des traitements comme l’imatinib (Gleevec) initialement au prix de plus de 100 000 $ par an, bien au-delà de la portée de la plupart des patients dans les PRFI. Même si la licence obligatoire a été utilisée dans certains cas pour produire des versions génériques moins chères, la complexité des brevets sur les produits biologiques rend cela plus difficile que pour les médicaments traditionnels à petites molécules.
- Vaccins contre la Covid-19 : La pandémie de Covid-19 a mis en évidence des disparités mondiales dans l’accès aux vaccins. Malgré le développement rapide du vaccin, les PRFI ont rencontré des obstacles importants pour obtenir des doses, car les pays à revenu élevé ont sécurisé la majorité des approvisionnements précoces. Les prix élevés fixés par les fabricants pour les vaccins brevetés, combinés à des défis de distribution complexes, ont encore exacerbé l’inégalité. Bien que des mécanismes comme COVAX visaient à faciliter la distribution mondiale des vaccins, ils étaient insuffisants pour répondre à la demande dans de nombreux PRFI.
Obstacles au-delà des coûts
En plus des coûts élevés, d’autres facteurs contribuent au manque d’accès aux médicaments essentiels dans les PRFI :
- Faiblesse des infrastructures de santé : même lorsque des médicaments génériques sont disponibles, la faiblesse des systèmes de santé, le manque de professionnels de la santé et la médiocrité des réseaux de distribution peuvent limiter leur accessibilité.
- Obstacles réglementaires et de propriété intellectuelle : Certains PRFI ne disposent pas de cadres réglementaires solides pour approuver les nouveaux médicaments, ce qui retarde leur disponibilité. De plus, les paysages de brevets complexes créés par les brevets secondaires (brevets déposés sur de nouvelles formulations, combinaisons ou méthodes d’utilisation) peuvent empêcher l’introduction en temps opportun d’alternatives génériques abordables.
Le débat sur la santé publique et la protection de la propriété intellectuelle
Le conflit entre la santé publique et la protection de la propriété intellectuelle est au cœur des discussions mondiales sur l’accès aux médicaments. D’une part, les sociétés pharmaceutiques soutiennent que les brevets sont essentiels pour favoriser l’innovation, en particulier dans une industrie où le développement d’un nouveau médicament peut prendre plus d’une décennie et des milliards de dollars. Sans les droits exclusifs conférés par les brevets, les entreprises affirment qu’elles seraient peu incitées à investir dans le développement de nouveaux traitements, en particulier pour les maladies qui affectent les PRFI.
D’autre part, les défenseurs de la santé publique soutiennent que le système des brevets, tel qu’il fonctionne actuellement, donne la priorité aux profits sur les personnes, en particulier en cas d’urgence de santé publique. Ils signalent des cas où des brevets ont été utilisés pour restreindre l’accès à des médicaments vitaux, comme lors de la crise du VIH/sida ou de la pandémie de Covid-19. Ils soutiennent que la santé publique, en particulier dans les PRFI, devrait prévaloir sur les bénéfices des entreprises, en particulier dans le cas d’urgences sanitaires mondiales.
L’accord sur les ADPIC et la santé publique
Reconnaissant la tension entre la protection de la propriété intellectuelle et la santé publique, l’Accord sur les ADPIC de l’OMC comprend certaines flexibilités qui permettent aux pays de prendre des mesures pour protéger la santé publique tout en respectant les obligations internationales en matière de propriété intellectuelle. Parmi ces clauses de flexibilité, il est prévu de:
- Licences obligatoires : l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC permet aux gouvernements de délivrer des licences obligatoires, ce qui leur permet d’autoriser la production d’un produit breveté sans le consentement du titulaire du brevet, généralement en échange d’une redevance. Cette mesure a été utilisée pour élargir l’accès aux médicaments essentiels dans les PRFI, comme pendant la crise du VIH/sida.
- Importation parallèle : l’Accord sur les ADPIC permet aux pays d’importer des médicaments brevetés d’autres pays où ils sont vendus à des prix inférieurs, ce qui permet aux PRFI d’acheter des médicaments à un prix plus abordable.
- Disposition Bolar : Cela permet aux fabricants de génériques de commencer à produire une version générique d’un médicament breveté avant l’expiration du brevet, afin qu’ils puissent entrer sur le marché immédiatement après l’expiration du brevet.
- L’articulation la plus importante de ces flexibilités a pris la forme de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (2001), qui affirmait que les ADPIC ne devraient pas empêcher les pays de prendre des mesures pour protéger la santé publique et promouvait l’utilisation de licences obligatoires pour les médicaments essentiels.
La dimension éthique : la santé publique en priorité
Au-delà des cadres juridiques, il existe un argument éthique plus large qui suggère que l’accès aux médicaments essentiels ne devrait pas être limité par les droits d’exclusivité accordés par les brevets. Les cadres des droits de l’homme affirment que la santé est un droit fondamental que les gouvernements ont le devoir de faire respecter. Cette perspective souligne que la communauté mondiale devrait donner la priorité à la santé et au bien-être des individus par rapport aux droits de propriété intellectuelle, en particulier en période de crise sanitaire. Les partisans de ce point de vue soutiennent que le système de propriété intellectuelle actuel n’est pas à la hauteur de ses responsabilités envers les populations les plus vulnérables, en particulier dans les PFR-PRI, et que des réformes sont nécessaires pour faire en sorte que la santé publique l’emporte sur les profits.
Initiatives mondiales pour lutter contre l’accès aux médicaments
Pour répondre aux préoccupations croissantes concernant l’accès aux médicaments essentiels, plusieurs initiatives internationales ont été mises en place :
- Le Medicines Patent Pool (MPP) : Fondé en 2010, le MPP s’efforce d’accroître l’accès aux traitements du VIH, de l’hépatite C et de la tuberculose en négociant des accords de licence volontaires avec des sociétés pharmaceutiques. Ces accords permettent la production de versions génériques de médicaments brevetés, ce qui les rend plus abordables et accessibles dans les PRFI. Pendant la pandémie de Covid-19, le MPP a étendu son mandat pour inclure les traitements et les technologies de la Covid-19, bien que la participation des grandes sociétés pharmaceutiques ait été limitée.
- COVAX et équité vaccinale : COVAX, codirigé par GAVI, l’Alliance du vaccin, l’OMS et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), vise à fournir un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19. Cependant, COVAX a fait face à des défis importants, notamment des pénuries d’approvisionnement et des déficits de financement, soulignant les difficultés à assurer l’équité mondiale en matière de vaccins.
- Le programme de préqualification de l’OMS : ce programme permet de s’assurer que les médicaments, les vaccins et les diagnostics répondent aux normes mondiales de qualité, d’innocuité et d’efficacité, en particulier pour les maladies répandues dans les PRFI. En facilitant l’accès à des produits de santé de haute qualité et abordables, le programme contribue à combler le fossé entre les médicaments brevetés et les besoins des PRFI.
Ce chapitre a mis en évidence les défis critiques associés à l’accès aux médicaments essentiels, en particulier dans les PRFI, et les tensions entre la protection de la propriété intellectuelle et la santé publique. Le prochain chapitre explorera les cadres juridiques qui régissent les brevets pharmaceutiques, en se concentrant sur l’Accord sur les ADPIC de l’OMC et les discussions en cours autour de la proposition de dérogation aux ADPIC pour les vaccins et les traitements contre la Covid-19.