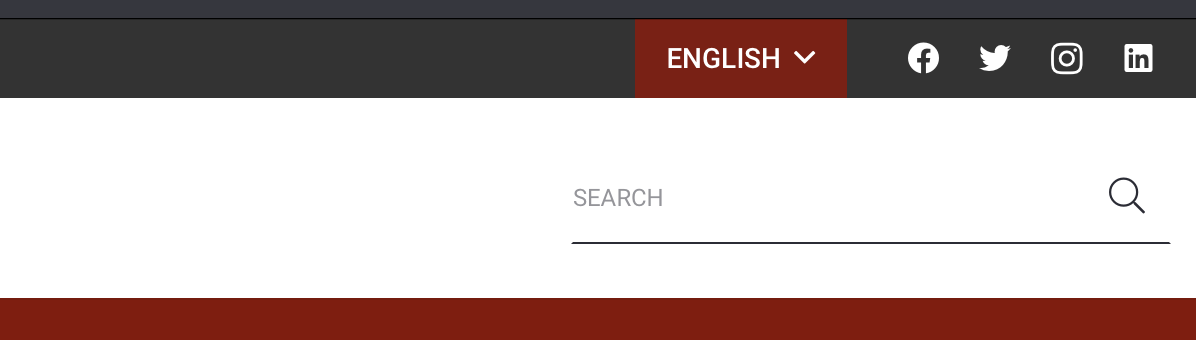Introduction
Un droit qualifié d’humain, ou – rectius – la catégorie des droits de l’homme est un défi à la fois à la jurisprudence et à la philosophie qui traverse la vie humaine de manière transversale. Même dans un passé profond, à l’époque classique, beaucoup ont considéré comment un être humain en tant que tel est digne de protection : non seulement de protection de ses biens, de ses biens, des usurpations extérieures, mais digne de protéger son intégrité (physique et morale), sa vie, son autodétermination, autant par d’autres pairs que par l’action de l’État, ce qui est loin d’être toujours légitime. La libre détermination de la pensée et la disponibilité de son propre corps sont les catégories les plus élevées dans lesquelles le concept de droits de l’homme peut être enfermé. Les mutilations génitales féminines sont un sujet complexe, et la complexité nécessite des approches différentes. Tout d’abord, une idée claire du droit dans son sens le plus profond, celui de la religion, ceux de concepts tels que l’universalité et la force de la norme et, surtout, celui de la personne. Ces concepts sont tous très présents dans les discours quotidiens, dans la production jurisprudentielle, dans la mentalité contemporaine, ainsi que dans les déclarations et les engagements pris au niveau international par divers acteurs importants sur la scène mondiale. Pourtant, le monde est loin de cette unification des normes, et de leur application uniforme. Les avocats ont le devoir clair de souligner cette lacune. Plusieurs États ont reconnu leur devoir d’intervention et ont pris des engagements en signant des déclarations spécifiques. Le monde n’a pas besoin d’autres proclamations, mais d’une protection réelle et uniforme des droits de l’homme.
Droit humain, droit divin ?
Il est particulièrement important de souligner que le sujet des droits de l’homme ne concerne pas uniquement le droit d’une religion ou celui des individus, ou celui des systèmes juridiques singuliers au niveau de l’État. Les droits de l’homme sont une question qui est apparue très tardivement dans la pensée juridique : elle s’est montrée à l’attention des juristes déjà dans la modernité. Néanmoins, il est présent – dans sa nature et ses fonctions – depuis les profondeurs de l’histoire, étant donné que dans sa conception philosophique, les droits de l’homme sont apparus et ont attiré l’attention des penseurs bien avant la modernité. Le concept a également été inexprimé dans les profondeurs de la pensée juridique, car (c’est peut-être le seul cas possible) il conduit à la question par excellence, la question des questions. Existe-t-il déjà une loi une fois que l’individu existe, ou la loi n’existe-t-elle que si elle est systématisée, c’est-à-dire une fois qu’elle est reconnue par un système juridique, définissant ainsi une relation entre plusieurs individus et un système de droit ? Le droit est-il un produit de l’histoire, comme une certaine conception matérialiste a eu l’intention de l’enseigner, ou le transcende-t-il ? A-t-elle besoin de légitimité ?
Dans l’Ouest
Il est communément admis que « ubi societas, ibi jus ». Il a toujours été une devise presque introductive à la réalité juridique, une marque incontestable, une conception typique qui trouve son origine dans l’antiquité de la doctrine juridique ou, rectius, dans les bases de sa conception analytique. Santillana a déclaré que l’herméneutique, donc l’interprétation, n’est pas le fruit de la connaissance mais la recherche du « dernier arbre le plus coloré du jardin de la connaissance ». Que saisissons-nous alors si nous allons interpréter la devise dans sa racine la plus profonde ?
En Occident, le droit est né comme fonctionnel à la relation entre les individus et les choses, ce que, dans une perspective civile moderne, nous pourrions définir comme des biens. L’expérience juridique occidentale a commencé à protéger les relations, en particulier les relations économiques. Les premiers droits ont été conçus si in rem, donc liés à une res, précisément à une chose ayant une valeur économique.
L’objet du droit était donc, comme mentionné, la protection de la propriété (y compris bien sûr la propriété collective) qui devint, lorsque cela était possible, l’objet d’une plus grande protection, celle des Dieux. Nous nous souvenons tous que Jupiter était le gardien des alliances, et ce n’est pas un hasard si nous parlons du caractère sacré des contrats. Bref, la présence du divin intervenait pour protéger la parole donnée, et les richesses qui étaient transférées, mais suggérait aussi la correspondance de l’ordre juridique à quelque chose non seulement humain, mais supérieur : l’ordre divin. Nous reviendrons sur ce point, apparemment lointain, qui concerne plutôt les droits de l’homme de très près.
Le droit a évolué et a évolué en fonction du développement des sociétés, des sensibilités des personnes qui les ont constituées, de la conception philosophique de l’existence et du fait que les différents peuples ont accepté et produit dans le devenir historique. Le concept des droits de l’homme, en revanche, semble être tardif. Philosophiquement, en particulier dans l’environnement grec classique, il y avait en effet un respect pour la personne en tant que telle. Aristote en parlait dans l’Éthique de Nicomaque, mais dans un contexte – celui de la Grèce classique – dans lequel en réalité un concept systématique de droit n’existait pas. En fait, Aristote parle du politiquement correct, et non techniquement du droit.
Dans la pensée religieuse chrétienne, qui partage beaucoup avec la pensée islamique, l’idée de la loi provenant de la nature en tant qu’ordre constitué par Dieu est forte chez Thomas d’Aquin, à cette époque définie à tort comme le « Moyen Âge » dans lequel tant de choses ont été élaborées. La position de Thomas est lucide et claire, et il capte beaucoup du christianisme mais aussi de ces concepts juridiques (d’abord et avant tout celui du droit lui-même). En lui, les droits sont des principes, ils sont de nature éthique et sont, avant tout, « generalissimi ». Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’une référence à une loi qui rejette le formalisme et la spécificité, à une loi qui ne se réfère pas à une norme faite par l’homme mais seulement perçue par ce dernier comme existant dans l’ordre structuré par Dieu. C’est un concept général qui transcende et n’a besoin ni de l’autorité politique qui le formalise ni de la plume du juriste qui l’élabore. Les droits ont toujours existé et ne sont pas générés mais reconnus. C’est un saut important, peut-être le saut qui amène à la reconnaissance des droits de l’homme.
Comme mentionné ci-dessus, seule la modernité fait naître les droits considérés comme « humains », c’est-à-dire les droits existant parce qu’un être humain est en soi son titulaire. Ce serait la fin de la conception du droit comme régulation d’une relation entre les choses ou les personnes : non seulement ubi societas, mais même ubi homo, ibi jus : la loi est là une fois qu’un seul homme l’est.
Et la clé de la reconnaissance des droits de l’homme réside dans le droit de la nature de Thomas, en droit naturel : c’est dans cette conception que les portes sont ouvertes à la reconnaissance du droit humain au sens technique et dans les ordres juridiques en utilisant des outils modernes. Le droit franchit les frontières des systèmes juridiques uniques et quelque chose de commun, ou – mieux dit – d’universel est reconnu : le droit international est né, le jus gentium au sens moderne, et cela amène à se demander quelles sources il reconnaît, une source qui ne peut être commune qu’à tous. Certains de ces droits, donc, sont connus comme inaliénables ainsi que naturels, et trouvent leur formulation au cours des Lumières.
Ce processus conduirait alors finalement à la reconnaissance des droits de l’homme au sens technique, en tant que norme réelle (jus cogens).
Le droit humain existe et il existe parce qu’un être humain est là. L’humanité le reconnaît, d’abord elle le voit, puis elle le formalise.
A l’Est
L’islam est un système juridique. Toute la création est soumise à Dieu, c’est l’islam idéalisé, c’est-à-dire la soumission à ses lois. La norme religieuse, la charia, est ce comportement dû par l’humanité pour qu’elle puisse être musulmane, qui est une partie cohérente et intégrante de l’ordre divin. Cela nous aide à comprendre au moins deux choses, toutes deux d’une importance fondamentale : la première est que dans l’islam, le seul législateur est Dieu, la seconde est que l’homme a la simple fonction d’interpréter la loi.
L’islam s’est étendu à différents territoires, entraînant avec lui la nécessité de faire de la multitude un unicum. Cette unicité est reconnue dans l’attitude islamique de reconnaître un seul ordre de choses, une seule loi, et de conformer l’action de tous à la volonté divine.
Le texte de référence est, bien sûr, le Coran, que certaines écoles de pensée considèrent même inséparable de Dieu lui-même. Un texte de référence censé n’être ni contradictoire, ni surmontable. Une source de droit apicale et non surpassable, à laquelle – par conséquent – toute autre source ou norme subordonnée doit se conformer. Il serait absurde d’essayer de synthétiser en un seul article la très riche histoire de la pensée juridique islamique, la lutte pour les sources et leur validité, et la légitimité de diriger le peuple islamique et de le standardiser sous une seule loi. Il faut cependant attirer l’attention sur la façon dont la loi islamique a élaboré sa terminologie pour désigner une source spécifique de sa loi, lue en deux sens distincts : c’est le concept de « tradition », qui dans le langage juridique islamique en arabe est rendu par la Sunna.
Mutilations génitales féminines : pas une institution juridique islamique
Au début de l’histoire islamique (vers l’an 200 de l’Hégire, soit deux siècles après le début de la prédication de Mahomet), la communauté islamique commence à écrire des anecdotes qui remontent à la vie du prophète lui-même. Ce serait une autre source d’inspiration pour les musulmans, les aidant – à l’instar infaillible du Prophète et de ses premiers compagnons – à mener une vie meilleure et à combler les lacunes qui, en raison de leur imperfection humaine, ne leur permettent pas de comprendre l’intégrité du Coran et d’abstraire le bon chemin à suivre à chaque occasion de la vie. Une série d’érudits certifieront si et à quel niveau chaque hadith (c’est le nom de l’histoire) est authentique et peut être référencé. Ce mécanisme est fondamental dans la conception de la loi de la voie islamique, sa réception des droits de l’homme et la question des mutilations génitales féminines.
En fait, lorsque l’islam s’étend, il se heurte à une série de traditions, à savoir la culture et les identités des convertis. L’Islam rencontre un monde déjà très riche en traditions. Voici l’interprétation différente de la loi faite par les différents docteurs de la loi, appelés à élaborer un jugement de légitimité sur les coutumes trouvées tout autour des territoires nouvellement trouvés : les résultats issus de leur interprétation sont étonnamment différents.
Lorsque l’islam rencontre l’Afrique, dans certains de ses pays, la mutilation génitale est déjà là. Il n’y a aucune preuve ou indice qui nous amène à croire que la mutilation génitale féminine a été générée par l’islam, mais plutôt que les musulmans ont trouvé cette habitude et que les nouveaux convertis ont continué à l’utiliser. Cela, au fil du temps, a été simplement consolidé et perçu comme une habitude islamique. En fin de compte, l’ancienne loi, qui est aussi la sunnah (comme tradition) et la nouvelle loi sont devenues confuses et ont donné aux observateurs l’idée qu’ils suivaient simplement la loi islamique, sans discerner une source de l’autre, et les habitudes pré-islamiques des habitudes islamiques.
La base juridique qui devrait garantir la conformité des mutilations génitales féminines à la norme islamique est un hadith, l’un de ceux qui n’ont pas été considérés comme authentiques, qui invite ceux qui interviennent sur la femme à le faire « doucement » car cela rendrait le visage de la femme plus radieux. Une autre note linguistique est importante à cet égard : la circoncision est appelée « tahara », qui renvoie à un concept de purification. Cela impliquerait donc le retrait d’une partie de l’appareil génital considérée comme « sale » au sens d’empêcher l’état de pureté dans lequel le musulman doit se trouver au moment où il accomplit certains actes ou vit certains moments d’une signification religieuse particulière. Le phénomène est donc affecté par toutes ces conditions psychologiques et sociales qui conduisent une communauté à devenir rigide dans ses pratiques défensives en présence d’un risque perçu : ici, à l’ère de la COVID, après 30 ans de diminution continue, on a assisté à une reprise de cette pratique, ainsi qu’à un abaissement des limites d’âge auxquelles sont soumises les filles (au Mali, elle en vient même à affecter les filles de deux ans ou moins). Cela implique de sérieuses difficultés à retrouver les victimes, et encore plus à développer des outils de réponse – ou de prévention – capables de briser un phénomène qui est maintenant considéré comme n’ayant rien à voir avec la religion mais avec des pratiques et des superstitions ancrées dans le temps.
En particulier, le phénomène est probablement lié au rite de passage, typique du moment difficile de transition entre la jeunesse et l’âge adulte.
Engagements sur les mutilations : la réponse globale nécessaire
Un tournant d’une grande importance, qui concerne à la fois la reconnaissance des droits humains et la dignité spécifique des femmes et leur intégrité physique, est le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (dit « Protocole de Maputo ») de l’Union africaine, daté de 2003. Le document a une fonction et une importance profondes, malgré l’absence parmi les signataires d’acteurs majeurs du continent africain tels que l’Égypte et le Maroc.
Le Protocole fonde son efficacité et sa légitimité sur plusieurs sources, auxquelles il est fait référence dans les considérations préliminaires :
Tout d’abord, l’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui prévoit l’adoption de protocoles ou d’accords spéciaux en cas de besoin, pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte,
Deuxièmement, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine à Addis-Abeba en 1995, qui a ratifié la recommandation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique,
In tertiis Article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui interdit toute forme de discrimination, donc également fondée sur le sexe, ou toute autre situation discriminatoire.
Ce protocole, qui compte 32 articles, a l’importance fondamentale de constituer une obligation effective et réelle envers les pays ratifiants : l’engagement est de faire reconnaître aux différentes législations, par les réformes appropriées du droit interne, des droits fondamentaux tels que la dignité, la vie, le consentement effectif à la célébration du mariage et surtout l’élimination de toutes les pratiques qui consistent en des actes portant atteinte à l’intégrité physique et mentale. des femmes, mentionnant explicitement les mutilations génitales féminines à l’article 5.
Cet article, intitulé « élimination des pratiques préjudiciables », dispose que les États membres « interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques préjudiciables qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et sont contraires aux normes internationales », et « prennent toutes les mesures, législatives et autres, pour éradiquer ces pratiques ». , de sensibiliser tous les secteurs de la société, de les interdire par des mesures législatives combinées à des sanctions, de protéger les femmes qui risquent d’être soumises à des pratiques néfastes ou à tout autre type de violence, d’abus et d’intolérance. La règle prévoit donc à la fois des actions préventives et répressives.
En Italie, environ 90 000 femmes sont soumises à cette pratique. Un nombre significatif qui devrait nous faire réfléchir sur l’efficacité des outils mis à disposition, même en dehors des territoires à majorité islamique. En 2006, la loi n ° 7 (dite « loi Consolo ») introduit de nouveaux cas pour renforcer la protection contre le phénomène des mutilations. Les articles 583bis, 583b sont ajoutés, qui prévoient une peine de 4 à 12 ans d’emprisonnement, augmentée d’un tiers si elle est commise à l’encontre de mineurs. L’élément matériel du crime est la cause de mutilation en l’absence de besoins thérapeutiques : évident, donc, même s’il n’est pas exprimé, la référence au Protocole de Maputo. Il s’agit donc d’une autre forme d’internationalisation et d’homogénéisation du droit, en l’occurrence prise par un pays européen à l’imitation d’un instrument juridique africain.
Conclusions
La mutilation génitale féminine ne doit pas être reconnue comme une institution juridique islamique ni comme une pratique obligatoire au sein d’une communauté islamique, mais plutôt comme une relique de cultures et de pratiques antérieures réparties sur un territoire qui deviendrait plus tard islamique et conserverait ses anciennes traditions. À ce jour, les politiques adéquates d’application de la loi n’existent pas parce que les engagements pris par de nombreux États et organisations n’ont trouvé aucun effet en dehors des déclarations solennelles. Les instruments juridiques existants sont pour la plupart obligatoires, mais ils ne se sont révélés ni suffisants ni efficaces : il convient de souligner que ce qui manque n’est pas l’instrument juridique – qui se manifeste dans le protocole de Maputo et dans d’autres diverses sources internationales qui, rappelées dans le protocole lui-même, ne peuvent être reconnues que par tous les signataires -. Cependant, ils manquent de capacité et de volonté pour remplir leurs obligations. Il convient de mentionner le système juridique soudanais, qui depuis 2020 punit la mutilation d’une peine de seulement 3 ans d’emprisonnement.
Une forme minimale de protection contre une pratique qui, loin des normes de la foi, constitue une humiliation évidente de l’intégrité psychologique et physique des filles ainsi qu’une pratique handicapante.